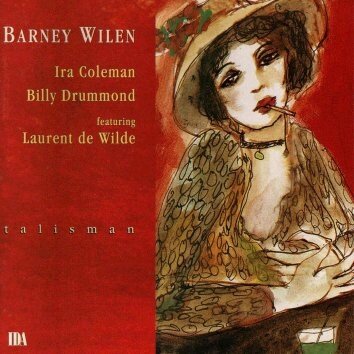LES MOTS DU JAZZ
Ruvo di Puglia, 2014
Article publié pour la première fois dans le magazine "Tempo", du Centre Régional du Jazz en Bourgogne.
Merci à eux de m'avoir commandé ce travail.
Les mots du jazz
I. « JAZZ » : UN SIGNIFIANT NOUVEAU ? — Pour aller vite, un signifiant nouveau c’est un mot qui ne trouve sa source dans aucune étymologie reconnue par un ensemble de linguistes. Quand une chose nouvelle apparaît, la plupart du temps on la désigne en prenant dans la langue des éléments déjà présents, que l’on combine ensemble de façon à désigner l’objet, ou la nouveauté. Il est va ainsi de «l’automobile», mot construit à partir de «auto» (soi-même) et «mobile» (qui se meut). On pourrait multiplier les exemples, et l’on se rendrait compte que dans une langue, les signifiants radicalement neufs sont fort rares.
Cette idée de surgissement radical, d’irruption brutale d’un mot (ou d’une chose) qui ne serait précédé par rien de déjà là nous est tout à fait insupportable. C’est pourquoi on a voulu — on veut toujours — trouver au mot «jazz» une étymologie. On va la chercher en Afrique ou dans la langue des bordels de la Nouvelle-Orléans; on suit à la trace les occurrences du mot dans les publications des années 1880-1915, et au bout du compte on s’y perd. Je signale quand même (en anglais il est vrai) un article qui fait le point non sans humour sur la question, publié sous le lien suivant[1].
Cela dit, de façon insistante, «jazz» est référé au sexe, si bien que le très distingué Eubie Blake déclarait ne jamais employer le mot devant des dames. On sait que pour nombre de musiciens africains / américains le terme de «jazz» sert de repoussoir, autant pour ses (soi-disant) connotations sexuelles que pour le détournement de la chose par le business américain blanc. Cette référence à l’éros est à la fois significative, et comique — un peu à la manière dont Jean-Pierre Brisset (1837-1919) ramenait, dans sa Grammaire Logique toutes les expressions de la langue à des questions de sexe, anticipant follement sur Freud autant que sur le mouvement surréaliste!
Un mot sans racine, ce n’est pas rien, surtout à une époque où l’on nous rebat les oreilles des roots et autres formes d’enracinement: identitaires, géographique ou culturel. Pourtant on devrait songer que, pour un peuple de déracinés comme les esclaves africains[2], avoir inventé une musique radicalement neuve et sans racines irait très bien avec l’idée de la nommer d’un mot lui-même issu de nulle part. Ou du ciel si l’on veut, comme un cadeau des dieux; plutôt que de la terre comme on l’imagine chaque fois qu’on (se) représente l’arbre du jazz constitué d’un énorme tronc (blues, gospel, ragtime, marches et quadrilles) d’où émergent les rameaux successifs du swing, du bop et autres styles du jazz.
Le signifiant « jazz » serait donc un cadeau du ciel. C’est pourquoi nous devons continuer à l’utiliser, sachant à quel point en son absence de racine, il est précieux pour préserver l’idée même de surgissement, d’irruption, d’arrivance enfin — pour le dire avec Derrida.
II. « JAZZ », UN SIGNIFIANT USÉ? — Il nous faut maintenant décaler un peu la perspective, prendre en compte l’histoire, et considérer un certain nombre de remarques insistantes qui nous viennent le plus souvent des musiciens eux-mêmes, et qui tendent à faire du mot « jazz » un signifiant usé, fatigué, qui a déjà trop servi, parfois même à de mauvaises causes. Souvenons-nous de Miles Davis, obsédé par l’idée de ne pas jouer deux fois la même note de crainte que celle-ci ne paraisse « vieille, usée », qui partageait avec nombre de ses confrères la plus extrême méfiance vis à vis du terme de « jazz ».
Dans son expansion universelle, le jazz a connu des temps difficiles où son existence fut négativement connotée («musique de sauvages»), puis une époque où il devint à la mode, sous divers climats et de diverses manières — de l’entertainment américain à l’accueil favorable par les élites en Europe — enfin, après les années 70, est venu le moment où son expansion médiatique a lentement régressé. S’il survit aujourd’hui, c’est sur un mode assez problématique et au bout du compte fort paradoxal.
Car d’une part on associe cette musique, et le mot qui la désigne, à une chose du passé, à une forme d’art dépassée, morte, et si l’on se sert alors du vocable c’est pour l’insérer dans un contexte marchand où il sert un peu de signifiant à tout faire, vantant ici un parfum, là une automobile, et pour finir un restaurant où «l’abus de jazz est recommandé pour la santé». Dès lors on comprend que tout ce qui se présente artistiquement comme reprise, revival et autres formes de l’exploitation du fond de commerce légué par les aînés ne parvienne pas à satisfaire vraiment ceux qui cherchent dans l’art autre chose qu’un divertissement policé, et/ou culturellement bien aligné.
D’autre part et par voie de conséquence, on relève une méfiance encore accrue de la part des musiciens eux-mêmes, soucieux de se démarquer de ces images trop lourdes à porter. On connait leur insistance à trouver d’autres termes pour désigner leur travail, «musiques improvisées» ici, ou «improbables» là, quand ce n’est pas « inclassables »[3]. Du côté des acteurs culturels c’est un peu la même chose: conscients de cette dévalorisation, ils tendent de plus en plus à donner à leurs manifestations, quand elles revendiquent une ligne artistique un peu soutenue, une dénomination qui fasse l’impasse sur le mot «jazz», ou alors de façon très allusive[4].
Ainsi donc, entre le neuf qu’il fut et l’ancien qu’il représente aux yeux de beaucoup, le « jazz » (la chose et le mot) a bien du mal à se frayer un chemin dans la modernité. Et pourtant, dans l’esprit de certains encore — dont je suis — «jazz» reste encore la seule manière de dénommer une musique dont la geste est unique — entre Afrique, Orient et Occident — et la chanson si belle qu’elle résonne à nos oreilles comme celle d’une aube éternellement recommencée.
2008
[1] Daniel Cassidy : How Irish invented jazz, Counterpunch, edited by Alexander Cockburn and Jeffrey St Clair.
[2] Dans son Abécédaire, Gilles Deleuze dit quelque part que le déracinement le plus radical se produit au moment de la libération des esclaves, quand ils n’ont plus aucun statut social. On en trouve une très belle image vers la fin du film Shenandoah, d’Andrew McLaglen (avec James Stewart et Maureen O’Hara), quand un tout jeune enfant noir « libéré » part sur un chemin qui semble bien incertain.
[3] Dans une rencontre initiée par l’ONDA, on a proposé naguère l’expression: « ces musiques… comment dire? »
[4] J’ai eu, pour ma part, les plus grandes difficultés à faire entendre aux divers partenaires du Bordeaux Jazz Festival (2001 – 2008), politiques, institutionnels, entreprises, public, que derrière cette appellation banale, et même triviale, se cachait une programmation rivée sur le plus vif des musiques, disons « actuelles ». D’où cette question: fallait-il changer la désignation du festival, et supprimer l’allusion au «jazz»? Mais pour y mettre quoi?