Barney Wilen, cavalier fou
BARNEY WILEN
CAVALIER FOU
« Tu traverses la société en diagonale. C'est un peu le parcours, comme sur un échiquier, c'est le parcours du fou mélangé avec le parcours du cavalier. Tu traverses en diagonale, de temps en temps tu fais un saut en « L », pour éviter, parce que tout le monde sait que tu marches en diagonale, et ils t'attendent au bout de la diagonale, eh bien tu n'y es pas. Parce que tu viens de faire un saut de cavalier. C'est ça un peu le jazz... C'est des échecs mélangés avec les dés quoi... »[1]
La diagonale du fou – et n'est pas fou qui se contenterait de le vouloir - jointe à l'écart du cavalier. Ça devrait permettre d'éviter qu'on t'assigne à une seule place, et qu'on t'affuble d'une étiquette. Même celle du « jazz », d'ailleurs. Il paraît qu'Archie Shepp, qui ne supporte pas ce mot, pense que je suis devenu de plus en plus noir au fil des années. Peut-être bien au fond, même si aux échecs on dit : « les blancs jouent et gagnent ». Je prends les noirs, avec l'espoir d'en effacer le destin, ou de m'y confondre.
Voyageur, on me dit voyageur. Pas tant que ça non plus. Cela dit, je reconnais quand même qu’il y eût bien des ascenseurs, des avions, des transferts, des trains, des automobiles, et que tout ça laisse des traces, et même des traces enregistrées. Mais c’est le lot des musiciens. Le vrai voyage, c’est autre chose. J'ai parcouru bien des kilomètres pour rester à la même place, pour tenter de ne pas bouger d'un pouce. Trop bouger, ça fait « Tilt », et la partie est perdue. Il faut dire plutôt interrompue d'ailleurs. Alors bien contrôler le mouvement, en garder le souvenir, filmer ces immobilités successives, fabriquer du voyage à partir du statique, du déplacement avec la succession des instants. Parce que la musique, elle, se joue de ces paradoxes : on ne reconstitue pas une mélodie à partir de l'immobilité des notes, il faut bien qu'elles se suivent, donc il y a un avant et un après. C'est la musique qui voyage, pas nous. Est-ce que ça fait sens ? En tous cas, j’ai pris à la lettre cette formule du « nomadisme », que les intellectuels du jazz ont souvent employé à son endroit. Avec ce que comporte cet art de vivre quand il est vécu par ceux qui le pratiquent, et qui est de savoir combiner l’errance avec un fondamental enracinement dans l’ici.
Tiens donc : juste dire ce qu'il convient de dire, pas vraiment y croire, mais pas non plus le trahir. C'est ma délicatesse, ma façon à moi d'être au plus près des choses, sans risquer l'esclandre, la provocation inutile, et sans céder non plus à une quelconque adhésion. Voilà ce qui me fascine dans la musique, ce qui m'y tient : parvenir à jouer de façon légère, de façon qu'on n'y accorde pas trop d'importance, mais quand même que personne ne se risque à dire que c'est seulement pas grand chose. La transparence du rien. J'aimerais que ça ne se sache pas, que celui qui écoute ne soit pas en mesure de dire si moi-même je crois à ce que je raconte, ou si j'en suis loin. Je n'en suis pas loin, et en même temps je n'y suis pas. Parce que là où je suis, je ne pense pas, et là où je pense, je ne suis pas. Cette faille. Voilà, ce saut du « L », ce risque, au saut du lit, qu'il soit nécessaire d'y retourner aussitôt.
Le son. « Le son de Barney » dit Jacques Thollot. Et il répète ça à l'envi, avant de laisser lourdement tomber ses mains, ses bras, sur la batterie. Cette manière d’adhérence sans attache, cette transparence embrumée, cette matérialité spirituelle, on doit pouvoir l'entendre dans le son. Fêlure ? Non, pas fêlure, normalité totale, pas de brisure, ou alors dernière. La mort (s’il faut…), sinon le jeu avec le monde comme il va. « Le son de Barney, il résonne encore, c’est ce qu’on appelle l’immortalité je crois, chez les curés… ».
Résurgences, apparitions, disparitions. Tout ça, c’est quand même un peu fabriqué, on se demande bien pourquoi d’ailleurs. Il se trouve simplement que j’ai une vie en dehors des scènes, en dehors de la scène médiatique, et ils ne doivent pas aimer ça, qu’on ne soit pas dupe… Alors on fabrique des « périodes », des « retraits », quand bien même vous avez continué de vivre et de jouer. Cela dit, je suis quand même d’accord sur une certaine évolution des choses dans les années 60, et j’y ai participé. Sans réserve.
« C’était une façon de chercher une autre voie, une façon très déstructurée - mais c’est comme ça dans le jazz - d’essayer de trouver une piste pour se sortir d’un sentiment d’enfermement. Il y a toujours eu des thèmes, mais ce qu’on a aboli souvent c’étaient les grilles d’accord, les suites harmoniques, et les choses comme ça. Et finalement on se retrouvait en train de jouer d’autres suites harmoniques, très déstructurées, ne dépendant que d’un fil très ténu de compréhension mutuelle. »[2]
« Bandini » ce n'était en aucun cas une provocation. On ne joue pas avec la mort d'un autre. Mais on y joue sa vie, sa brûlure, son terrible éclat. Aucune bravade encore dans le fait de partir, de voyager. Ce voyage en Afrique : la diagonale Tanger – Zanzibar, avec le « L » du Sénégal. Au bout du bout, ces collages, ces échanges en écho, une certaine façon de glisser une voix, la mienne, dans les couleurs de là bas. Y aller, en être revenu comme on dit, et puis jouer avec les musiques rapportées. Poser sa voix autour, dedans, à côté, dans les marges.
Quant à la véhémence du free jazz, je n'y crois guère, et ne m'en suis approché que de loin. Il y a des écarts qui tuent (Bandini). C'est en gardant quelque chose de constant dans le son que j'ai aimé construire « Moshi », dont le thème titre fait penser à des musiques qui se sont épanouies un peu plus tard de l'autre côté de l'Afrique. L'Ethiopie, mon utopie insue. Un très doux balancement. Il faut garder ça de ces rencontres, de ces collages. Je veux bien être ailleurs si l'on veut, mais Ayler. Je ne comprendrai jamais pourquoi il a tant fait peur. Il avait plus à voir avec l'enchantement qu'avec la révolte, ou le cri. « Moshi », c'est la danse rieuse, dans la nuit, de ces femmes aux yeux brillants. Cette joie incroyable, ouverte, déployée. Tindi Abalessa... Sensible aussi dans Tezeta ou encore Gubèlyé (Mulatu Astatké) : j’aime le son des saxophonistes (Tesfa Maryam Kidané & Fèqadu Amdè-Mesqel) , très doux et très libre en même temps, et ce balancement unique, qui n’est pas le swing du jazz, mais qui est tout aussi mystérieux, et difficile à reproduire. C’est une question de soleil, de parfums, de couleurs, de saveurs culinaires. Il me semble que nous avons été très proches, à l’époque « Moshi », ça devait s’entendre, d’un côté à l’autre du continent. Voilà un voyage.
Même la douceur extrême est risquée, et on doit l'entendre, dans le son et dans le phrasé. On doit percevoir le risque de la violence, la violence d'y faire obstacle, et finalement le choix de la douceur, mais avec tout cet itinéraire. Ce parcours de cavalier fou, marche impossible, écart non prévisible, pas prévu donc : improvisé. C'est le jazz. Un peu. Du jazz, on m'a dit qu'il ne pouvait en être question avec les chansons françaises, qu'il n'y avait pas de « nouveau jazz » mais juste l'ancien, et j'en passe. Encore des carcans, des cancans. Le jazz, pas en zigzag[3], mais pas loin quand même.
C'est une chose étrange, la présence au monde. Ce qui fait qu'on y est, ou qu'on y est presque, ou qu'on y est pas du tout. Mettez ça en rapport avec le fait de voyager, et amusez-vous. A être là tout en étant ailleurs. Plus justement, à être là, sans être ailleurs, mais en laissant entendre à ceux qui vous entourent que peut-être... Une réserve, pas une distance. Un léger décalage. Comme dans l'écriture, ou dans la musique. Il est difficile d'adhérer au monde, et pourtant il faut bien y être, ou alors décider d'en sortir.
Je n'obéis pas. Je n'obéis à aucune injonction. Mais en même temps je fais ce que je dois. Sans faux-fuyants. Voilà, c'est ça : ne pas fuir, ne pas fuir faussement. Pas « esquiver », mais « s’esquiver » quand il n’est plus nécessaire d’être là. Dire non si c'est ça qu'il faut dire, mais ne pas être dans le négatif à tout prix.
Je suis un promeneur allongé. Un voyageur horizontal. Avec quelque chose d’une nonchalance de bord de plage, de bord de mer. C'est que « nonchalance » (avec chance, et surtout élégance), ça veut dire « ne tenir compte que de ce qui est important ». Le reste... « peu me chaut »... Nonchalance, c'est l'élégance suprême de celui qui fait la part entre ce qui compte vraiment, et ce qui importe peu. C'est là que nous sommes attendus. Il y a une certaine - et avérée - nonchalance africaine qui est tout sauf de la paresse. L'occident s'y est trompé longtemps...
Et puis ne pas faire de tout ça un drame, encore moins une légende. Prendre ça plutôt par la bande. C'est à dire encore une fois la figure de la diagonale, avec la possibilité d'un « L » à tout moment. Je n'aimerais pas qu'on parle de moi comme d'un saxophoniste légendaire. Quelle stupidité. Il n'y a rien de légendaire. Je ne me cache pas, je suis là où l'on vient me chercher, mais il faut y venir. Je ne ferai pas le premier pas, mais volontiers tous ceux qu'il faudra faire, si l'on vient me chercher. Et encore faut-il savoir que j'y suis sur le mode de mon être, qui est d'y être réservé.
Philippe Méziat
2010

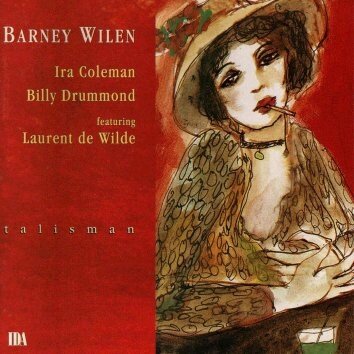


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F04%2F1386065%2F106426273_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F57%2F49%2F1386065%2F106406700_o.jpg)